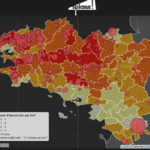Après avoir abordé le problème des « kilomètres alimentaires » dans un article précédent, revenons sur l’étrange phénomène de la marginalisation progressive de l’agriculture biologique. Depuis plusieurs mois, on assiste à une recrudescence d’articles dans la presse généraliste concernant le secteur bio. Le débat tourne autour d’un certain nombre de questions : Faut-il manger bio, est-ce meilleur pour la santé, faut-il payer plus cher pour des produits bio, etc. Et si on inversait le débat ? Faut-il consommer des produits issus de l’agriculture conventionnelle? Est-ce meilleur pour la santé ? D’où viennent les produits et quelles en sont les méthodes de production ?
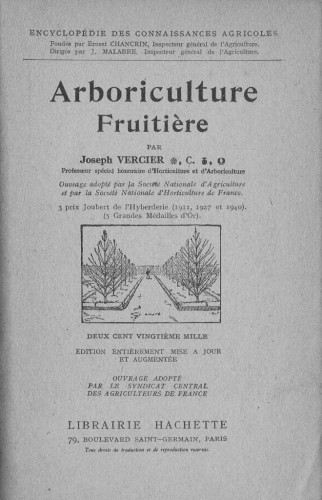 On oublie en effet que l’expression « agriculture biologique » (un pléonasme !) n’est apparue qu’au tournant des années 50 justement pour se démarquer de l’agriculture « conventionnelle » prônant l’usage croissant d’intrants chimiques et de produits phytosanitaires dans une logique productiviste. Depuis plus de 10,000 ans, le modèle de production agricole dominant a donc toujours été « biologique » (rotation des cultures, compostage, lutte biologique, engrais verts, jachères, maintien de la biodiversité etc)…sauf depuis les 60 dernières années. Ce sont les développements de l’agro-industrie, des modes de transports sur des distances de plus en plus longues grâce au pétrole abondant et bon marché, et de la logique de la grande distribution qui ont accéléré l’essor de l’agriculture conventionnelle et la marginalisation du secteur bio. On en est donc arrivé à une situation ni plus ni moins « inversée » qui requiert l’étiquetage des produits bio ou même l’interdiction temporaire de la vente du purin d’orties il y a quelques années.
On oublie en effet que l’expression « agriculture biologique » (un pléonasme !) n’est apparue qu’au tournant des années 50 justement pour se démarquer de l’agriculture « conventionnelle » prônant l’usage croissant d’intrants chimiques et de produits phytosanitaires dans une logique productiviste. Depuis plus de 10,000 ans, le modèle de production agricole dominant a donc toujours été « biologique » (rotation des cultures, compostage, lutte biologique, engrais verts, jachères, maintien de la biodiversité etc)…sauf depuis les 60 dernières années. Ce sont les développements de l’agro-industrie, des modes de transports sur des distances de plus en plus longues grâce au pétrole abondant et bon marché, et de la logique de la grande distribution qui ont accéléré l’essor de l’agriculture conventionnelle et la marginalisation du secteur bio. On en est donc arrivé à une situation ni plus ni moins « inversée » qui requiert l’étiquetage des produits bio ou même l’interdiction temporaire de la vente du purin d’orties il y a quelques années.
Photo : Arboriculture Fruitière – Dépôt légal 1910, 25e édition, 1950. Où est le mot « biologique » ?
On oublie de dire que la majorité des variétés de fruits et légumes que l’on trouve dans le commerce ont été développées en fonction de leur rendement et de leur potentiel de longue conservation. A peine une petite dizaine de variétés de tomates se retrouvent sur les étals, alors qu’il suffit de feuilleter les catalogues des vendeurs de semences ou des banques de semences anciennes comme Kokopelli ou les Seed Savers anglo-saxons pour se rendre compte de l’incroyable diversité des semences, toutes adaptées à des régions ou des sols différents et produisant une palette de gouts extrêmement variés.
On oublie de dire que pour faciliter le transport et la distribution à grande échelle, les fruits et légumes qui arrivent sur les étals sont calibrés et sélectionnés pour une présentation uniforme. Là aussi on en arrive à créer une perception totalement artificielle qui n’a plus grand rapport avec la réalité, comme tout jardinier amateur peut le constater. La calibration génère parfois des situations rocambolesques comme « l’affaire des carottes tordues ». Heureusement, on commence à constater un assouplissement de la législation dans ce domaine, puisque 26 fruits et légumes ne doivent plus répondre à des normes de taille ou de forme depuis Juillet 2009. Les agrumes, tomates, pommes, poires etc. restent soumis au calibrage.
Dans la même logique de rendement et de présentation, de plus en plus de légumes comme les tomates, courgettes, concombres, laitues ou même fraises et fleurs coupées sont cultivées hors-sols dans des serres immenses, et ce sans obligation de le préciser de la part des producteurs. Des techniques récentes se développent comme l’aéroponie (les plantes sont « alimentées par un brouillard nutritif obtenu par brumisation de la solution nutritive dans milieu fermé » source Wikipédia) ou l’ultraponie (« un nouveau système aéroponique amélioré, basé sur un fin brouillard produit par un brumisateur à ultrasons. » source Wikipédia). N’est-ce pas précisément ce genre de produits qu’il faudrait étiqueter et « labelliser » !
Poser les bonnes questions amènera les bonnes réponses dans ce genre de débat.